
Rouge
Jour 1
Je suis un condamné. Un condamné à mort.
Je suis surpris car je ne savais pas que l'on me donnerait ce papier et ce crayon et ce temps encore pour les utiliser. Mais c'est la première fois que je suis condamné à mort alors je ne peux pas être au courant de tout. Des usages, des us et des traditions de la chose.
C'est un droit que j'ai.
Je ne sortirai pas de cette cellule avant d'avoir noirci ce papier.
Un mot ou un livre, comme je veux.
J'ai longtemps attendu. Mon avocat m'a dit que ce n'était pas grave, que je pouvais prendre le temps que je voulais, que maintenant que tous les recours avaient été épuisés, la décision définitivement actée, il n'y avait plus rien de pressé.
Vous allez penser que j'aurais pu ne rien écrire, jamais, et mourir ainsi de ma belle mort.
J'aurais pu, oui.
Mais eux ont très envie de glisser mon cou dans le nœud rond de la corde des pendus et moi je n'en peux plus d'être coincé ici.
Savez-vous que la cellule d'un condamné est ronde ? Oui, parfaitement, ronde. C'est un autre droit que j'ai. Pour adoucir sa fin de vie, pour l'accompagner dignement vers la sentence, on épargne à un condamné la vue de toute arête abrupte, de toute forme cubique.
Mais moi, je n'ai jamais supporté les ronds ou les cercles.
J'ai toujours préféré les lignes bien nettes et les virages à angle droit.
Alors j'écris, parce que j'ai vraiment envie de sortir d'ici.
Jour 2
Je ne m'étais jamais lancé dans l'écriture alors me retrouver devant cette feuille blanche, aussi soudainement et dans ces conditions, ça me stresse.
C'est marrant, le blanc et le rectangle de la feuille m'impressionnent tant que j'en oublie ma mort programmée.
Je ne sais pas quoi écrire mais je sais ce que je ne dirai pas avant de sortir d'ici. Je ne dirai pas que je veux vivre. Rien en moi n'a pris réellement conscience de ma condition de futur corps suspendu dans le vide, corps vainqueur de la pesanteur grâce à la force implacable de la corde qui le retient à une poutre. Qui le retient par le cou. Je ne m'identifie en rien à ce corps mou. Rien en moi ne hurle que je veux vivre car rien en moi ne sait vraiment que je vais mourir.
Je sais juste que je veux sortir de cet œuf ridicule.
Il faut se rendre compte quand même qu'ici comme ailleurs, ce n'est jamais la base qui décide. C'est une constante incroyable, une immuabilité de la hiérarchie, partout et de tout temps. J'ai dit à mon avocat tant de fois à quel point ce mur unique, lisse et courbe me rendait fou. Il y a les anciennes cellules juste à côté pourtant.
J'ai rencontré trois fois le Professeur Mollet. Mollet, directeur de la mission Mollet : "Humaniser la peine capitale". C'est lui l'idée des cellules rondes. Il l'a à chaque fois bien défendu d'ailleurs son idée. De mon côté, je n'ai pas su argumenter. Je ne faisais que répéter : "Sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici…" Mais à la fin, c'est toujours lui qui finissait par sortir.
Il n'y est jamais resté dans ce fichu ventre rond. Il n'a jamais pris le temps de se sentir englouti par cet espèce d'estomac, cette paroi, cette membrane qui me mâche et me mâche jour après jour. J'ai l'impression que lorsque je sortirai d'ici, je ne serai qu'une boulette de chair ramollie, puante, informe, qu'il suffira d'évacuer en tirant d'un coup sec sur une corde bien tendue.
Jour 3
Je comprends mieux pourquoi je préfère les lignes droites et les angles.
Je précise à ceux qui me liront peut-être que j'ai amplement mérité toute cette rondeur. Je sais bien que la plupart des gens n'en ont rien à faire des états d'âme d'un assassin. Et ils ont entièrement raison. Moi-même, avant d'être ici et de commettre ce que j'ai commis…
Mais j'aimerais quand même parler d'autre chose que de cet endroit. Laisser autre chose.
Tout d'abord, je me souviens à peine de mon crime. Je l'ai raconté aux policiers, je me suis laissé arrêter, je n'ai rien nié, jamais, car je sais que c'est moi qui l'ai fait. Là-dessus, rien à dire.
Tout a été très soudain et très confus. Je n'ai que des réminiscences. Ou des images plutôt, beaucoup d'images. Comme si j'avais revécu ma vie juste à l'instant de tuer. J'ai revu ma vie avant une autre mort que la mienne.
Il faudrait que j'arrive à mettre en ordre.
J'ai vu un petit garçon, moi, debout sur une scène, avec d'autres enfants. J'ai vu toute la foule des parents, amis venus admirer les costumes, le défilé. J'ai surtout revu ma honte dans ce tissu bleu que ma grand-mère avait transformé en habit de petit ange. A côté, il y avait Superman et un pompier, un samouraï et un policier aussi. Et il y avait moi, mes cheveux frisés la veille pour porter l'auréole au-dessus de mes yeux bleus. La honte et la colère auraient dû me clouer au pied de la scène ou au fond du siège de la voiture mais je ne sais pas, j'ai pas osé. Pour ma grand-mère ou ma mère, je ne sais pas, j'ai pas osé. J'étais bleu ciel pour les autres et rouge vif de rage en dedans, juste pour moi.
J'ai vu Etienne, qui aime sa femme, si ouvertement et ça se voit. Enfin je le voyais, avant.
Etienne. Le bureau juste en-dessous du mien, le nom juste en-dessous du mien et le salaire aussi, juste en-dessous du mien. Je l'ai toujours battu au tennis, toujours. Il était bien meilleur que moi, un vrai joueur de raquettes et je savais à chaque fois sur quelle balle il retenait son bras. J'en avais tant besoin au bureau d'Etienne, j'avais tant envie d'être lui. Et chaque fois, il s'empêchait de me battre
J'ai vu aussi Colette, qui garde tous ses secrets, tout le temps.
A l'école, petite fille, je la coinçais dans un coin de la cour et je la piquais avec les épines de la rose que je faisais semblant de lui offrir. Je voulais qu'elle me les dise ses secrets. Ceux qu'elle racontait avec ses copines ou avec un autre petit garçon de la bande.
Au collège, on allait au café, on allait partout ensemble. Je la faisais rire Colette et c'est vrai que j'étais drôle. Je pensais qu'en la faisant rire, elle me les dirait tous ses secrets.
Plus tard, je l'ai épousée. Avec mon argent, on a une maison, des vacances, des amis, une piscine, des enfants, tout. Mais il n'y a rien à faire. Aujourd'hui encore je m'aperçois que je ne sais rien d'elle. Même au parloir, jamais, pas un de ses secrets.
J'en ai sûrement vu d'autres. Aujourd'hui je peux les décrire comme ça, parce que je prends le temps qu'il me reste. Je prends le temps de mettre en ordre des images.
Ce que j'ai vu en vrai, c'est le rouge. En un instant, je me suis trouvé à cet endroit de mon âme, de mon cœur, de mon être (comment nomme-t-on ce qui fait notre essence ?) où je n'ai cessé d'enfermer le rouge de toutes mes impuissantes rages. Je suppose que chacun d'entre nous enferme quelque part le rouge de toutes ses rages.
Le juge m'a posé la question pendant le procès : "Qu'est-ce qui vous a pris ?"
Il y avait au deuxième rang de gauche, à peu près au milieu, la femme de l'homme que j'ai tué. Lorsque le juge m'a posé la question, j'ai tourné la tête vers elle. Instinctivement, sans réfléchir, j'ai voulu lui adresser la réponse. Mais je n'avais pas de réponse. Tourné vers elle ou tourné vers le juge, j'essayais sincèrement de trouver l'explication. Je ne revoyais que ma fureur d'assassin. Bien malgré moi, il ne me revenait rien d'autre qu'elle. Entière, pas même amoindrie par le chagrin de cette femme ou par le remord d'avoir ôté une vie.
Mon silence durait et le juge a répété : "Qu'est-ce qui vous a pris ?"
Je la regardais, elle. Je n'ai tué qu'une fois et c'est l'homme qu'elle aimait, lui et pas un autre, qui a fait naître l'assassin acharné que j'avais jusque là totalement ignoré. Je ne pouvais pas dire devant elle à quel point cet homme avait pu me donner envie de le tuer.
Pour cette femme dont le visage penché vers l'avant évitait mon regard, dont le corps refusait de s'affaisser sous le poids de mon silence, pour cette femme que je m'imaginais amoureuse en deuil du corps de son amant, pour elle, dans la masse compacte et mouvante de ma fureur la compassion et le regret ont tracé un très net sillon, sitôt creusé, sitôt englouti. Mais un sillon si net que j'aurais aimé qu'elle puisse en percevoir la trace.
Jour 4
Je vais bientôt avoir fini je crois.
Ce qui me soulage aussi, c'est de savoir que cette boule de fureur crue, vivante, que je sens là, à la place de mon ventre et de mon cœur, va en finir en même temps que moi.
Du moins je l'espère.
Se pourrait-il qu'elle ait, vue sa force et sa consistance, une existence propre ? Se pourrait-il qu'elle s'échappe des êtres dont elle avait pris possession et qu'elle erre, allant décrire au-dessus de nous de larges cercles dans l'infini ? Ayant choisi sa cible, se pourrait-il qu'elle ouvre soudain l'un de ses cercles et qu'elle s'enroule lentement puis de plus en plus vite, de plus en plus près ? Venue de si haut, lorsqu'elle s'abat tel l'œil du cyclone sur l'âme visée, elle l'aspire dans le trou béant et évasé que sa chute vertigineuse et tournoyante a tracé dans l'espace.
Aurais-je dû répondre au juge que je passais par là et que la fureur m'a choisi, moi ?
Se pourrait-il que ce soit pour cela que je préfère les lignes bien droites ?
Ce jour-là, ce dimanche-là, j'étais parti seul à vélo dans les rues de la ville. Je les avais tous laissé à la maison, devant l'écran. Ils n'avaient pas voulu venir avec moi.
Ca m'avait contrarié, beaucoup, et beaucoup plus que d'habitude.
Je n'arrivais jamais à les convaincre de venir avec moi. Les enfants étaient comme Colette, ils ne me mettaient jamais dans leurs secrets. Avec eux aussi j'ai essayé d'ailleurs mais après tout peut-être est-ce ma faute. Je n'étais pas souvent là.
J'avais donc pris seul mon vélo. Je voulais le disque rond du soleil au-dessus de moi pour me chauffer. Je voulais le roulis des pneus sur l'asphalte. Je voulais le balancement de mon corps au rythme du pédalier. J'y pense maintenant, oui, et c'est étrange, à ce moment-là je voulais les rondeurs du monde.
Je roulais sur le large trottoir de l'avenue.
Je roulais sous le vent tiède du printemps, sous quelques chants d'oiseaux, parmi les odeurs d'un dimanche sans moteur.
Je roulais au milieu d'un temps à part, du vent dans ma chemise et du répit dans mon corps, du répit dans mon âme.
Je sentais poindre un peu de bonheur.
Je voyais arriver vers moi un homme, à vélo lui aussi. Nous étions totalement seuls et je nous ai imaginé complices de ce moment à nous, loin d'eux. Nous allions nous croiser. Je voulais lui sourire. J'étais presque bien.
C'est sa voix surtout, le ton de sa voix, qui a dû attirer l'œil du cyclone.
"Vous avez pas vu qu'il y a un sens, non ?" (La piste cyclable, à cet endroit, est prévue dans le sens de la montée. Et j'étais moi dans le sens de la descente).
Sa voix à lui, impérieuse et cassante, marquait la satisfaction hautaine du redresseur de torts du dimanche. Et du lundi, et du mardi. La satisfaction hautaine des gardiens de tous les jours, de toutes les lignes, de tous les codes, de tous les cercles. Cet inconnu, ce veilleur héroïque, m'avait remis à ma place, rappelé à la règle, au respect des choses (non, mais) et m'avait dépassé sans même que je vois son visage. Il allait continuer sa route sans plus se soucier de moi.
Tout ce rouge ! Tout ce rouge en moi ! Je l'ai rattrapé en courant. Et, c'est écrit dans le rapport de police, j'ai frappé sa tête contre les arbres, contre le bitume, contre les murs. Le rouge, il fallait qu'il sorte.
Juste après, j'ai compris que cette couleur si vive qui m'entourait partout n'avait pas jailli de moi.
Jour 5
J'ai bien mérité d'être pendu.
Je n'arrive pas à refermer l'écrin de ma rage.
Je n'ai rien vécu de si terrible pourtant. Dans ma vie je veux dire. Pas de souffrance extrême, pas de drame, pas de "conditions sociales et familiales défavorables".
Je vais arrêter d'écrire.
Je voudrais des bras pour m'entourer, des yeux pour me consoler et pour m'accompagner. J'ai beau faire le fier, ne rien ressentir de l'envie de vivre, j'ai peur quand même.
Je pense à cette femme, au milieu du deuxième rang à gauche, et je ne comprends pas le lien entre elle et cet inconnu dont je n'ai jamais vu le visage. Je n'ai que le son de sa voix sentencieuse, avec juste ce qu'il faut d'intérêt puis d'indifférence.
Je l'entends encore parfois et il n'y a rien à faire, c'est toujours ce rouge qu'elle appelle.
Je l'entends et toujours je prends sa tête et je la cogne contre les arbres, contre le bitume et contre les murs.
Kathy Godiveau





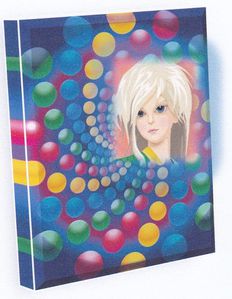


 Le cercle vif et agile
Le cercle vif et agile





